Tropiques Toxiques (BD)
Cette BD documentaire revient sur des décennies de scandale d'utilisation du chlordécone dans les Antilles françaises.
C'est en 1973, sous la présidence de Pompidou, que le chlordécone commence à être utilisé en Martinique. Il est mis en service pour lutter contre le charançon. Un insecte faisant des ravages sur les bananiers. Le pesticide est utilisé jusqu'aux années 1990.
Bien sûr, son utilisation aura de lourdes conséquences sur la faune et la flore locale, ainsi que sur la santé de la population.
En 2018, le journal quotidien "Le Monde" publie une enquête de santé nationale établissant un lien entre un taux élevé de cancer dans les Antilles et l'utilisation du chlordécone. Cette étude indique que la quasi totalité des guadeloupéens et martiniquais sont contaminés par le pesticide. Malgré cela, le président Macron prétend que le chlordécone ne serait pas cancérigène.
Une étude de 2003 dévoilait que le sang de 9 femmes antillaises sur 10 était contaminé au chlordécone. Les conséquences sont terribles, une réduction de la motricité fine, utilisation des muscles des doigts dans le but de réaliser des gestes précis, minutieux, s'est fait ressentir chez les nouveaux-nés. Chez de nombreux bébés, une baisse du développement neurologique a été découvert par des chercheurs.
William Dab est épidémiologiste, directeur général de la santé entre 2003 et 2005, selon ce spécialiste une seule situation sanitaire est comparable à celle du Chlordécone dans les Antilles françaises, il s'agit du célèbre drame nucléaire de Tchernobyl, en URSS. Dans le deux cas, la contamination est incurable, expose chaque individu et a une durée de vie indéterminée. Allant jusqu'à plusieurs siècles.
En 1969. Une commission s'était rassemblée pour interdire l'utilisation du chlordécone, jugé trop dangereux de part sa toxicité.
Un rapport ressortira dans les années 2000 et accable les services de santé martiniquais. Il démontre que ces services étaient au courant de la pollution des eaux en 1991, hors ils prétendent avoir été informés seulement en 1999 et n'ont agit qu'au début de la décennie suivante.
En Janvier 2008. Le gouvernement de l'époque, Fillon premier ministre, lance un plan chlordécone pour établir l'étendue de la pollution dans les Antilles. Le but est d'informer les populations et de soutenir les exploitants agricoles impactés.
Depuis 2008, les producteurs guadeloupéens ont réduit de 70% l'utilisation des phytosanitaires. Afin de mettre en place une agriculture respectueuse de l'environnement.
En 2009, les syndicalistes guadeloupéens et martiniquais appellent à la grève, la mobilisation est au rendez-vous. Les revendications sont une augmentation des salaires et des retraites ainsi qu'une baisse des prix de première nécessité.
En 2012, pourtant, le ministre des Outre-Mer, Victorin Lurel autorisait les épandages aériens, ce qui s'avère être un désastre écologique. Ce même Lurel était responsable de la chambre d'agriculture de Guadeloupe au cœur du scandale du chlordécone entre 1981 et 1993. Suite à une mobilisation conséquente des écologistes, les épandages ont cessé.
Un autre scandale se confond avec celui du chlordécone, celui du glyphosate, depuis 2010, il est sur le marché, chacun peut s'en procurer. Chaque année, 800 000 tonnes de glyphosate sont sont répandues sur la planète. La quasi totalité de la population mondiale en est imprégnée.Ce produit est cancérigène. Il est aussi responsable de malformations congénitales, le glyphosate est classé comme perturbateur endocrinien.
Pour comprendre le scandale du chlordécone aux Antilles, il faut avoir connaissance du système en place. Ce sont les békés, blancs descendants des colons, qui contrôlent l'économie locale. Autre élément à prendre en considération, la banane n'est pas endémique sur les terres antillaises, elle y a été introduite par les colons européens, au XVIème, aux Antilles. L'histoire des cultures de bananes est profondément lié à l'esclavage.
Le scandale du chlordécone dépasse le cadre des Antilles, ce pesticide a également été utilisé en grande quantité dans plusieurs États africains. À partir de 1987, l'entreprise française "La compagnie fruitière"a utilisé du chlordécone dans ses exploitations au Cameroun, il a été épandu au moins jusqu'en 1997. En Côte d'Ivoire également le chlordécone a été abondement utilisé, une étude de 2003 révèle que 3000 hectares agricoles sont pollués.



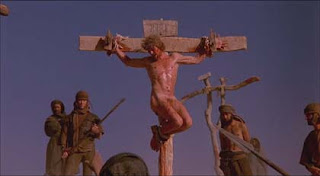
Commentaires
Enregistrer un commentaire